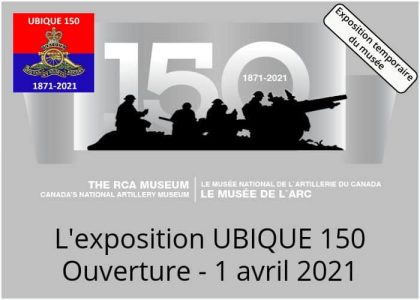UBIQUE 150


En 2021, le Musée de l’ARC célèbrera UBIQUE 150 dans le cadre de différentes activités enrichissantes tenues à l’échelle locale, régionale et nationale. Le Régiment royal de l’Artillerie canadienne a élaboré une campagne qui a pour but d’entretenir l’esprit de corps, de célébrer notre patrimoine régimentaire et d’établir des liens avec les Canadiens. Le 150e anniversaire de fondation des Batteries A et B est une excellente occasion de rendre hommage à notre histoire et au patrimoine unique du Régiment royal.
Exposition virtuelle à 360 degrés : Le Musée de l’ARC accueillera une exposition temporaire célébrant le 150eanniversaire des Batteries A et B. Ces unités ont été les premiers éléments « à temps plein » ou « réguliers » de l’Armée canadienne après la Confédération, ce qui représente une étape importante de l’évolution du Canada. L’exposition temporaire du Musée sera ouverte jusqu’en décembre 2021. Le lien ci‑dessous donne également accès à l’exposition virtuelle sur 360 degrés.
Exposition interactive UBIQUE 150 : Le Musée de l’ARC a également mis sur pied une exposition d’éléments graphiques couvrant les 150 dernières années. Il devait s’agir d’une exposition utilisant des écrans tactiles, mais la pandémie de COVID‑19 nous a forcés à changer nos plans. L’exposition est maintenant diffusée en ligne et on y offre des photos interactives illustrant des périodes et représentant des sous-catégories. Le lien ci‑dessous vous y donne accès. Nous espérons qu’elle vous plaira.
Pièces d’artillerie patrimoniale : Nous avons voulu souligner l’importance du développement de la technologie de l’Artillerie canadienne au cours des 150 dernières années. Cet armement, qui était à l’origine constitué de canons mobiles de plus petite taille, rassemble maintenant de grosses pièces d’artillerie servant au tir indirect. La technologie de l’époque était intégrée aux pièces, entraînant l’augmentation de la cadence de tir, de la létalité, de la mobilité, de la précision et de la portée. Pour les servants, une pièce d’artillerie est bien davantage qu’un simple équipement. Les drapeaux consacrés du Régiment sont aussi ses pièces. Chaque pièce porte le monogramme du souverain. La pièce représente la force et la persévérance du Régiment.
Nous avons ajouté six textes explicatifs sur les pièces patrimoniales dans le Musée pour présenter les pièces d’artillerie. Nous avons également ajouté des liens vers les six pièces ci‑dessous.
Les officiers et les militaires du rang de la batterie A : En 2021, nous soulignerons le 150e anniversaire de la formation des batteries A et B dans le cadre d’événements organisés par l’équipe UBIQUE 150 partout au pays. Les officiers et militaires du rang ayant formé initialement les batteries A et B furent les premiers militaires canadiens permanents à temps plein. En 1871, des officiers et des militaires du rang arrivèrent des quatre coins de l’Ontario et du Québec pour accomplir des tâches de garnison et suivre une formation en artillerie. Une fois leur formation terminée, ils sont retournés dans leurs unités de milice dispersées à la grandeur du pays pour transmettre le savoir acquis. Grâce à la formation des batteries A et B et au transfert de leurs connaissances, l’Artillerie canadienne devint beaucoup plus ubiquiste au Canada. Mais qui étaient ces premiers artilleurs et qu’ont-ils fait pour contribuer à rendre l’Artillerie canadienne UBIQUE?
Du seizième au dix-neuvième siècle, à diverses époques, l’Angleterre et la France avaient à leur actif des soldats impériaux au Canada. Un changement majeur survint sur le plan militaire en 1853-1854 alors que la majorité des membres des forces régulières britanniques toujours présentes quittèrent les colonies canadiennes pour aller mener la guerre en Crimée ou défendre d’autres avant-postes coloniaux. À la suite de ces événements, la province du Canada adopta la Loi de la Milice de 1855, qui autorisait l’organisation d’une milice volontaire active composée d’au plus 5 000 officiers et militaires du rang, dont une cavalerie, une artillerie de campagne, une artillerie de garnison et une infanterie. En 1867, la Confédération du Canada amorça le processus visant à mettre en place un gouvernement responsable. Après la Confédération, le Canada, en tant que nation autonome, devint responsable, en partie, de la défense nationale. La création de nouvelles batteries d’artillerie et écoles d’artillerie fit partie de la contribution demandée. La première Loi de la Milice post-Confédération de 1868 mit toutes les milices actives sur un pied d’égalité. En 1869, il existait pas moins de 28 batteries au Canada.

En février 1870, les Britanniques commencèrent à retirer leurs soldats impériaux du Canada, cette opération se poursuivant jusqu’en novembre 1871. Le 20 octobre 1871, l’Ordre de la milice no 24 autorisa la création de deux batteries d’artillerie de garnison à Kingston et à Québec. Les nouvelles unités devaient pourvoir à l’entretien et à la protection des deux forts respectifs, accomplir les tâches de garnison et servir d’écoles d’artillerie. Au départ des Britanniques, on ferma également l’École d’artillerie créée en 1864. Les nouveaux soldats de la Garnison étudièrent également dans les écoles. Les nouvelles fonctions entraînèrent des responsabilités ordinaires à temps plein dans les Garnisons de Kingston et de Québec. Chaque batterie comptait deux divisions, soit l’artillerie de campagne à cheval, et ses quatre canons à âme lisse de 9 livres, et l’artillerie de garnison à pied, équipée de deux obusiers à âme lisse de 24 livres et de douzaines de canons à âme lisse de 32 livres montés sur affût, plus anciens. Tant pour la batterie A que pour la batterie B, le commandant de l’École était un officier de l’Artillerie royale détaché des autorités impériales ayant obtenu ses qualifications à Shoeburyness, en Angleterre. Il devait superviser l’instruction, les exercices militaires et la discipline à l’École. Le premier commandant de la batterie A, le lieutenant-colonel (devenu major-général, Sir) George A. French, fut un leader énergique et imposant. Il obtint sa commission de l’Artillerie royale en 1860 et fut capitaine-adjudant au sein de l’Artillerie royale à Kingston de 1862 à 1866. La nomination suivante fut celle du premier chirurgien de la batterie A, O.S. Strange.

En 1871, les districts militaires de l’Ontario et du Québec demandèrent que des volontaires, tant des officiers que des militaires du rang, faisant partie de la milice active deviennent membres des batteries A et B à des fins d’instruction et pour accomplir des tâches. À partir des réponses reçues, ils choisirent les meilleurs candidats. On exigeait notamment que les candidats soient en bonne santé, qu’ils mesurent au moins 5 pieds 6 pouces et qu’ils aient un tour de poitrine d’au moins 34 pouces. Les candidats devaient également appartenir à la 1re ou 2e classe de la milice canadienne. À leur arrivée, ils devaient être examinés par un médecin. Les officiers commençaient par suivre le cours de formation de courte durée totalisant trois mois, pour lequel ils étaient rémunérés à un tarif inférieur à un dollar par jour. S’ils montraient une aptitude pour un éventuel service militaire, l’École les gardait pour la formation de longue durée qui exigeait encore neuf mois de leur part. Une fois la formation de courte durée réussie, les officiers recevaient le montant total alloué à leur grade. En 1871-1872, un capitaine avait droit à 2,82 dollars, un aide-chirurgien obtenait 2,43 dollars, un sergent-major de batterie recevait 1,00 dollar, un sergent était payé 0,80 dollars, un caporal, 0,70 dollar, un bombardier, 0,60 dollar et un artilleur, 0,50 dollar par jour. En plus de sa solde quotidienne, chaque soldat enrôlé avait droit à une livre de viande et à une livre de pain. On remettait du matériel aux soldats pour équiper les casernes, dont du combustible pour se chauffer et s’éclairer. Ceux qui possédaient des chevaux recevaient également du fourrage.
Les hommes s’engageaient à servir pour une période de 12 mois. Une fois la période de 12 mois terminée, tant les officiers que les militaires du rang pouvaient quitter et retourner dans leur ancienne milice active ou, sur recommandation du commandant, demeurer sur place pour une période indéterminée. La plupart de ces officiers et militaires du rang accomplissaient des tâches de garnison et suivaient une formation d’artilleur pendant environ un an. Après leur formation, la majorité des soldats retournaient dans leur unité de milice d’origine pour transmettre les compétences acquises. Le système était conçu pour garder la plupart des officiers et des militaires du rang pendant une courte durée, puis les retourner dans leur ancienne unité de milice. On s’assurait ainsi d’avoir un roulement régulier de soldats, ce qui contribua à la transmission du savoir partout au pays. Toutefois, un autre groupe d’artilleurs membre de la batterie A formait les soldats. Ceux qui formèrent les soldats s’étant présentés à l’École sont souvent demeurés à la batterie A pendant une période indéterminée en tant que premiers membres de milice permanents à temps plein.

Les premiers soldats qui se présentèrent à la batterie A n’étaient pas de jeunes recrues. Bon nombre des premiers militaires du rang à se joindre à la batterie A étaient d’anciens membres des forces régulières britanniques ayant pris part à l’expédition de la rivière Rouge en 1870. Après la libération des forces sous le commandement de Wolseley, de nombreux militaires décidèrent de demeurer au Canada. D’autres militaires arrivaient d’unités britanniques ayant été dissoutes ou ayant quitté le Canada. La batterie A comptait 37 hommes qui servirent auparavant dans l’armée impériale (adjudants et sous-officiers) et qui s’enrôlèrent ensuite dans la milice active de l’Ontario. La formation donnée reprenait les principes et les attentes de l’artillerie britannique, et les instructeurs chevronnés veillaient à ce que les élèves reçoivent une formation adéquate. Les militaires du rang de la batterie A provenaient de différentes régions de l’Ontario. Sur les 106 premiers militaires du rang, 63 provenaient de la Batterie de campagne Kingston, 19, de la Batterie de campagne Toronto et 9, de la Batterie de campagne Wellington. Parmi les autres batteries et garnisons, on comptait quatre militaires du rang de la Batterie de campagne London; trois, de l’Artillerie de la Garnison Ottawa; deux, de la batterie de la Garnison St. Catharines; un, de la Batterie de campagne Hamilton; quatre, de la batterie de la Garnison Toronto; un, de la batterie de la Garnison Cobourg. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on venait de partout pour faire partie de la batterie A. Par ailleurs, les militaires devaient réussir un processus de sélection; la Milice retenait les meilleurs.
Environ la moitié du premier contingent de la batterie A provenait de la Batterie de campagne Kingston. On forma d’abord la Batterie d’artillerie de campagne de la Milice volontaire en 1856. La Milice la renomma Batterie de campagne Kingston en 1894, puis la 32e Batterie, ACC, en 1920; son nom changea encore dans les années 1930 et 1940. En 1954, la Batterie se fusionna avec le « 60th Light Anti-Aircraft Regiment, RCA ». Une portion considérable des membres provenaient de la Batterie de campagne Toronto. On comptait des batteries d’artillerie dans la région de Toronto pendant la guerre de 1812. En 1813, on forma la « Volunteer Incorporated Artillery Company », qui était toujours en service lors de la Rébellion de 1837-1838. Avec l’entrée en vigueur de la Loi de Milice de 1855, le nom fut remplacé par Batterie de campagne Toronto. En 1895, celle-ci devint la 9e Batterie de campagne. Le 11e Régiment de campagne de Guelph fournit lui aussi plusieurs artilleurs. En 1857, les unités militaires déjà en place formèrent le 1er Bataillon de Wellington. En 1866, la batterie de la Garnison Guelph fut intégrée à la 1re Compagnie du 30e Bataillon de Wellington. En 1871, elle devint indépendante et fut renommée Batterie de campagne Wellington.

Bon nombre des premiers artilleurs de la batterie A connurent de brillantes carrières. Le premier capitaine-adjudant, William Henry Cotton, occupa les fonctions d’inspecteur général de la Milice de 1912 à 1914. L’artilleur Henry Walters fut l’un des premiers membres de la batterie A et devint professeur au Morrin College à Québec. Josiah G. Holmes fit aussi partie des premiers membres de la batterie A; il fonda par la suite la batterie C en Colombie-Britannique. Il connut une brillante et remarquable carrière militaire. Par ailleurs, parmi les premiers artilleurs de la batterie A, mentionnons le major D. T. Irwin, qui joua un rôle de leader et de formateur à l’École. Irwin succéda à French; il fut nommé commandant de la batterie A en 1873.
Parmi les premiers membres de la batterie, Samuel B. Steele fut la seule recrue non officier à son arrivée à avoir reçu le titre de grand artilleur. Sam Steele était né en Ontario en 1849. Il s’enrôla dans la Milice de Simcoe, prit part à l’expédition de Wolseley, puis s’enrôla dans la batterie A en 1871. Il avait une bonne capacité physique, il était costaud et il mesurait six pieds. Il maîtrisa rapidement les techniques d’artillerie. En 1873, Steele quitta la batterie A et devint le troisième homme à faire partie de la police à cheval du Nord-Ouest (NWMP). Il participa à la Rébellion du Nord-Ouest, puis organisa une police montée nommée les « Steele Scouts » sous la direction du major‑général Strange. On lui attribua le surnom de « Smooth Bore Steele » en raison de son passé d’artilleur spécialisé dans le canon à âme lisse de 9 livres à la batterie A. Il dirigea le détachement du Yukon pendant la ruée vers l’or du Klondike et commanda la cavalerie de Strathcona durant la guerre des Boers. Le Musée de l’ARC possède la première liste nominative de la batterie A. Sam Steele s’engagea auprès de la batterie A le 3 novembre 1871. Il s’enrôla en tant qu’agriculteur en compagnie de son frère, Richard.
Le premier soldat à signer la liste nominative de la batterie A fut le sergent‑major John Mortimer le 25 octobre 1871. Mortimer devint par la suite instructeur-chef adjoint en artillerie, puis sergent-major à la batterie A. Il était originaire de Shoeburyness, en Angleterre, et fut le premier instructeur britannique de maniement d’armes de type Armstrong. Après 22 ans de service au sein de l’Artillerie britannique et une mise à la retraite obligatoire, il immigra au Canada et s’enrôla dans la « Red River Force », puis dans la batterie A. Bon nombre des 37 anciens soldats britanniques avaient terminé leur période de service maximale de 22 ans avant de s’enrôler dans la Milice active canadienne. La batterie A comptait de nombreux instructeurs de première classe, comme John Mortimer. Ce dernier acquit son expérience dans l’Armée britannique, puis la transmit à la Milice active de la batterie A. Les recrues rapportèrent les connaissances ainsi acquises dans leurs unités de milice aux quatre coins du Canada. Les écoles d’artillerie offraient un cadre à des militaires du rang, comme le sergent-major John Mortimer, pour faire part de leur vaste expérience militaire acquise dans l’armée britannique aux artilleurs canadiens. Il ne fait aucun doute que Mortimer mérite une mention d’honneur.
Il fallut environ trois mois pour mettre en place l’effectif des deux batteries. En mars 1872, Kingston comptait un capitaine, trois lieutenants, un aide-chirurgien, sept sergents, quatre caporaux, quatre bombardiers, trois trompettistes et 110 artilleurs installés au casernement « Tête-de-Pont », ce qui donna au total 133 officiers et militaires du rang, sans compter le lieutenant-colonel French. Tous les officiers et militaires du rang appartenaient à différents corps de milice et étaient attachés à la batterie A à des fins d’instruction ou de formation. Ils donnèrent des instructions en fonction du grade qu’ils avaient en quittant leur batterie. Ils formèrent les artilleurs pour qu’ils puissent accomplir toutes les tâches demandées en fonction des postes attribués. Il convient de noter que le détachement de Toronto est souvent ignoré lorsqu’il est question de l’histoire des batteries A et B. La batterie A envoya également un groupe à Toronto. Ces soldats occupèrent des postes permanents à temps plein à Toronto. Le premier groupe fut composé d’un lieutenant, d’un sergent, d’un caporal, d’un bombardier, d’un trompettiste et de vingt artilleurs.


La batterie A connut une progression rapide en raison des solides qualités de leader de ses dirigeants et de la grande compétence de ses officiers et militaires du rang. Selon un rapport daté du 10 janvier 1872, le lieutenant-colonel French affirma, au sujet des batteries A et B : « d’après ce que j’ai vu, je suis convaincu que leur formation marque une époque distincte dans l’histoire de l’artillerie canadienne ». Il poursuivit en déclarant que tout officier ou artilleur peut « apprendre ses fonctions de manière approfondie, en s’engageant pour une période longue ou courte, et à la période de l’année qui lui convient le mieux ». Il signala que la conduite de ses hommes avait été en général exemplaire. En 1874, des sous-officiers commencèrent à se voir offrir de plus longues périodes de service, jusqu’à 3 ans, auprès de la batterie A, avec la possibilité de renouveler leur période de service. Au fil du temps, d’autres effectifs permanents s’ajoutèrent à la batterie A.
En 1871, les Canadiens portaient un uniforme presque identique à celui de la défunte Artillerie royale britannique. Il y avait toutefois une différence : les Canadiens avaient retiré le mot UBIQUE de leurs armoiries. En 1871, le mot UBIQUE ne se retrouvait pas sur les armoiries des artilleurs canadiens puisque ceux-ci n’avaient pas mérité le droit de le porter. La Milice arborait des armoiries représentant des honneurs et des distinctions qui lui furent décernés successivement, tout d’abord par le roi Guillaume IV en 1832. Les batteries d’artillerie constituées dans la province du Canada en 1855 et celles mises sur pied par les batteries A et B en 1871 arboraient les armoiries britanniques, sauf que le mot CANADA remplaçait l’inscription UBIQUE. En 1925, le roi George V, pour souligner et honorer la contribution majeure de l’Artillerie canadienne pendant la Première Guerre mondiale, autorisa l’usage de l’inscription UBIQUE. Alors qu’elle se faisait de plus en plus présente, l’Artillerie canadienne ajouta la devise UBIQUE à ses armoiries en 1926.